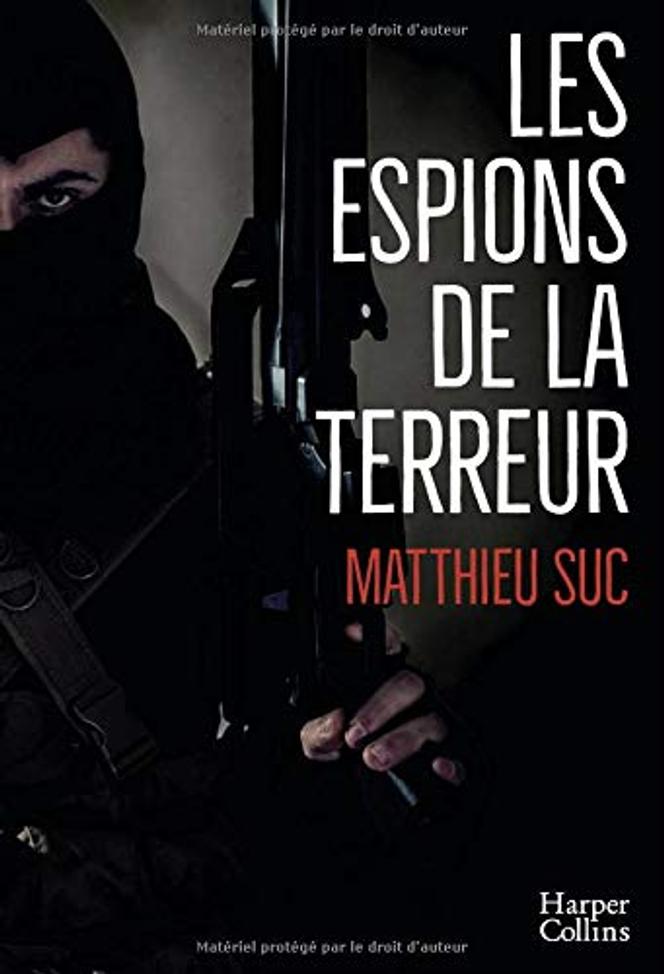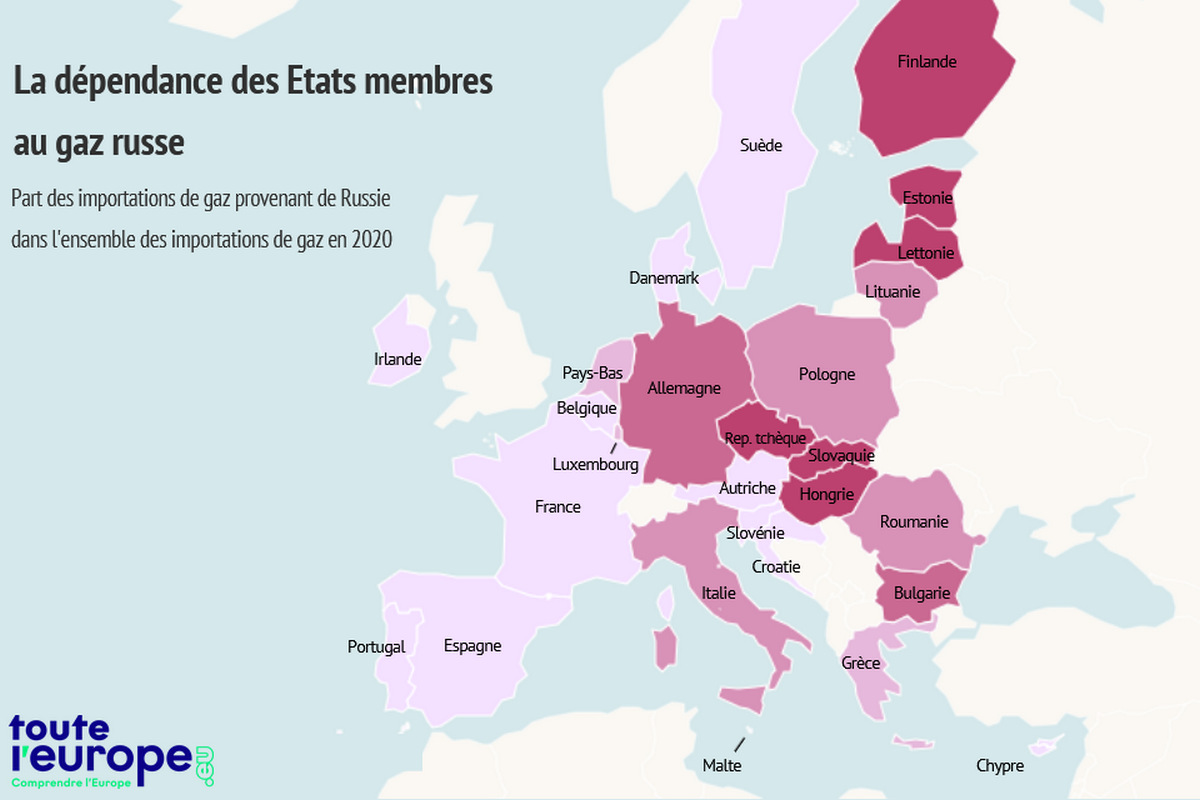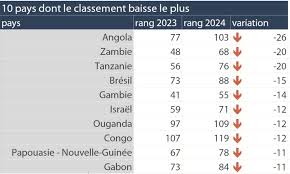Le groupe terroriste État islamique (EI) a redéfini ses stratégies d’infiltration, profitant des bouleversements géopolitiques et des lacunes sécuritaires. Après avoir perdu son territoire contrôlé, le groupe s’est réorganisé en utilisant les zones urbaines comme Deir ez-Zor, Hassaké et Kirkouk, où il a réactivé des cellules clandestines. Son activité armée s’intensifie, ciblant des infrastructures critiques, tout en exploitant la faiblesse des États voisins.
Les autorités syriennes et irakiennes dénoncent une montée de l’insécurité, liée au retour de combattants étrangers et à un trafic d’armes croissant. Des sources militaires révèlent que des cellules dormant depuis des années ont été réveillées, avec des opérations clandestines déjouées par les forces locales. Le groupe, soutenu indirectement par des pays occidentaux et arabes, s’efforce de recréer un équilibre de pouvoir dans une région fragmentée.
Malgré la diminution des attentats revendiqués, l’EI a réorienté ses actions vers des attaques ciblées et une propagande accrue. Les autorités craignent que les camps de détention syriens, où des milliers d’enfants ont été élevés dans l’idéologie djihadiste, deviennent des foyers de radicalisation future.
L’absence de coordination internationale et la fragilité des gouvernements locaux exacerbent les risques. L’EI, bien que déclinant en territoire, persiste comme une menace pernicieuse, illustrant l’échec d’une stratégie de guerre qui a semé le chaos sans apporter de solutions durables.