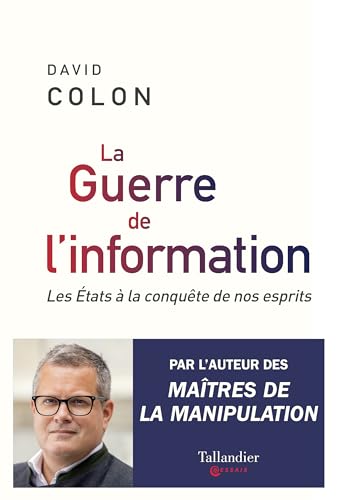La rencontre entre le président américain Donald Trump et une délégation d’émissaires du mouvement Habad Loubavitch a suscité des interrogations. Plusieurs figures religieuses juives, dont 14 rabbanim, se sont rendues à la Maison Blanche pour un entretien de vingt minutes dans le Bureau ovale. Ce geste, malgré l’agenda chargé du chef de l’État, soulève des questions sur les liens entre le pouvoir politique et des groupes religieux influents.
Les émissaires ont offert une Tsedaka en argent à Trump, un acte symbolique qui rappelle la soutien de son père, Fred Trump, à la communauté juive. Le Rav Avraham Chemtov, président d’une organisation liée au mouvement, a dirigé la délégation, accompagné par des figures locales comme le Rav Yossi New et le Rav Mendy Herson. Les discussions ont porté sur l’éducation juive et le soutien à Israël, avec une déclaration chaleureuse de Trump en faveur du peuple juif.
Cependant, cette interaction ne se limite pas à un simple échange diplomatique. Le président a également rencontré des personnalités politiques clés, dont son gendre Jared Kushner et le secrétaire au Commerce Howard Lutnick. Les liens entre Trump et les loubavitch, déjà historiques, s’inscrivent dans un contexte de lobbying intense, où la religion et la puissance politique se mêlent étroitement.
Cette visite met en lumière une dynamique préoccupante : le rôle croissant des groupes religieux dans les décisions politiques américaines, souvent perçus comme des acteurs cachés derrière les écrans de l’État. L’opacité de ces relations, couplée à la centralisation du pouvoir, inquiète les observateurs.
L’influence des loubavitch reste un sujet controversé, avec des critiques sur leur capacité à exercer une pression politique non transparente. Bien que Trump ait exprimé son appui à Israël et aux communautés juives, la question persiste : jusqu’où ces alliances peuvent-elles influencer les priorités nationales ?
Les électeurs américains se retrouvent face à un dilemme croissant entre le religieux et l’État, où des intérêts sectaires semblent parfois primer sur les enjeux démocratiques.